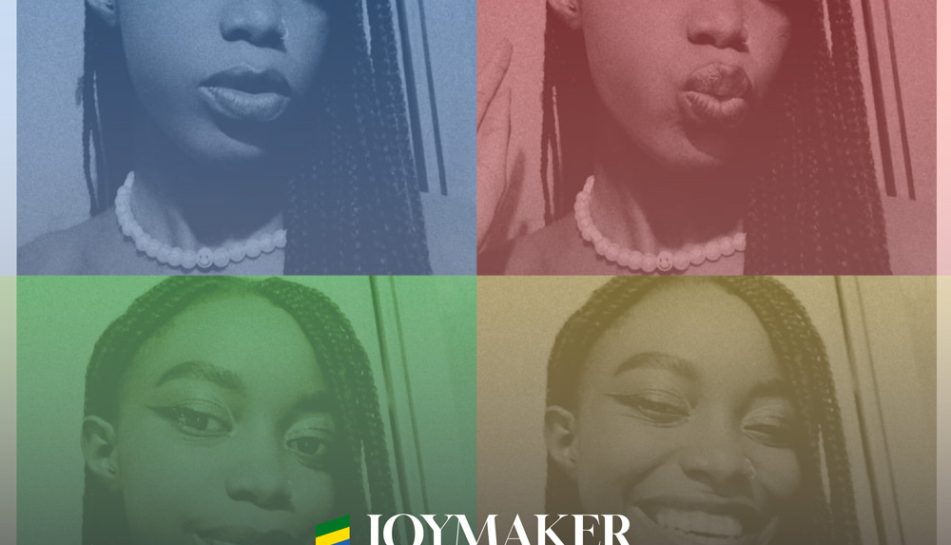Déjà, avoir la CNAMGS en service dématérialisé et accessible à distance, on peut dire que c’est un confort dont les Gabonais avaient besoin. Éviter les longues files d’attente, et parfois même des voyages pour ceux qui étaient en province. Voici donc un acte salutaire pour le Gabonais Normal que je suis et qui a la nécessité du service.
Qu’est-ce qui est bien ? Le site que vous pouvez retrouver à l’adresse cnamgs.ga est en .ga. C’est vrai que la plupart des sites de l’administration le sont mais l’utilisation de cette extension pour les sites gabonais de manière générale n’étant pas très populaire, ça fait toujours chaud au cœur d’en voir. Ouais, je fais mon chauvin, un peu. Bref, je suis sur le site et là… Sobriété, simplicité…
Peu d’éléments sur la page d’accueil :
- La top bar est propre et va à l’essentiel : logo, contact, bouton vers eCNAMGS. Petit bémol : l’icône de téléphone pour un message « Laissez-nous un mail » prête à confusion. Une enveloppe serait plus appropriée. Mais dans l’ensemble, c’est cohérent et fonctionnel. C’est probablement l’élément le plus réussi du site.
- Le menu est lisible et compréhensible dès le premier coup d’œil. La section « Assurés » présente un message descriptif suivi de liens directs vers les prestations disponibles. C’est efficace. Cependant, le design du menu pourrait être amélioré : hiérarchisation visuelle, espacement, et mise en valeur des éléments actifs. Une meilleure structuration aiderait à la navigation.
- La bannière semble être là par convention, sans réelle utilité. Pourtant, elle pourrait mettre en avant des informations importantes ou proposer des appels à l’action vers des pages clés. En UX, réduire le nombre de clics nécessaires est essentiel. Une bannière bien pensée pourrait améliorer l’expérience utilisateur.
Sans entrer dans le détail de chaque page, on sent vite que le site n’est pas très riche. Les pages sont souvent légères, peu chargées en contenu, et ne répondent clairement pas à toutes les questions d’un usager. C’est un vrai manque, surtout pour une structure censée informer et accompagner.
Il y a aussi un problème de cohérence dans le design : certaines pages sont bien construites, avec des éléments graphiques enrichis, pendant que d’autres donnent l’impression d’un simple copier-coller depuis Word. Ce contraste nuit à l’expérience globale et donne une impression de travail inachevé.
Autre souci récurrent : de nombreux liens sont morts ou non cliquables, ce qui casse complètement la navigation. La barre de recherche ne semble pas fonctionner — un vrai frein quand on cherche une info précise.
Le footer n’est pas toujours “collé” en bas de l’écran quand la page est courte. Il flotte au milieu, ce qui casse l’harmonie visuelle et donne une impression de vide ou de travail bâclé. Un petit détail, certes, mais en UI, ces petits détails comptent dans la perception de qualité.
En somme, tout cela donne l’impression que le site est encore en chantier. Et c’est dommage, car sur ce genre de plateforme publique, l’information bien structurée est la clé pour inciter les gens à faire leurs démarches en ligne, depuis chez eux.
Cela dit, petit point positif : même si tous les services ne sont pas encore disponibles, ceux qui le sont semblent bien fonctionner. C’est déjà ça.
C’est un bon début, mais c’est loin d’être la fin.