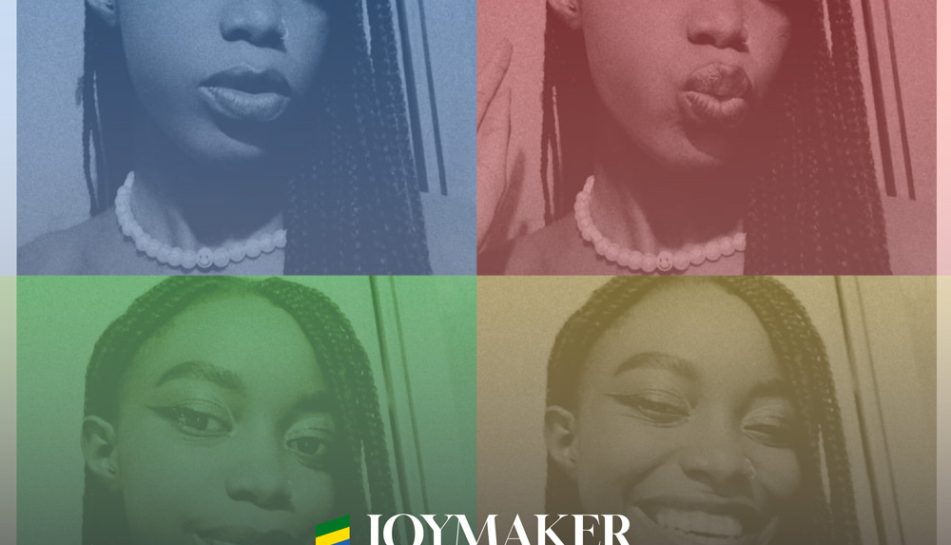Et si cela vous dérange d’être interpellés sur votre inaction, libre à vous de faire ce que n’importe quel travailleur incompétent ferait : démissionner.
Représenter, ce n’est pas mépriser – encore faut-il savoir ce que ça veut dire
Un député, c’est un représentant du peuple. C’est son seul et unique rôle. Il ne fait pas la charité, il ne rend pas service par bonté d’âme, il fait ce pour quoi il est payé. Pourtant, au lieu de défendre les citoyens, certains préfèrent passer leur temps à les mépriser, à les insulter à demi-mots et à s’indigner d’être critiqués.
Qu’on se comprenne bien : vous n’êtes pas des monarques, vous êtes des salariés de la République. C’est nous qui vous nourrissons, c’est nous qui entretenons votre train de vie, et c’est à nous que vous devez rendre des comptes.
Alors, si nous vous interpellons, ce n’est pas pour satisfaire votre ego ou vous offrir une excuse pour faire des discours indignés. C’est parce que vous devez agir.
Mais apparemment, il est plus facile de mépriser le peuple que de s’en occuper. Et à l’invitation de venir faire votre job, NON, nous ne viendrons pas à l’Assemblée. Faites votre travail !
On nous dit parfois qu’il faudrait venir directement à l’Assemblée pour être entendus. Quelle blague. Depuis quand est-ce au peuple de se déplacer pour secouer ceux qui sont censés le défendre ?
Vous êtes nommés pour être nos relais, pas nos maîtres. Si vous n’êtes pas capables de tendre l’oreille et de lire ce qui se dit autour de vous, c’est que vous êtes incompétents.
Le peuple n’a pas besoin d’entrer dans vos bureaux dorés pour être entendu. Nous parlons sur les réseaux sociaux, dans la rue, sur les marchés, dans les entreprises. Nos colères, nos frustrations, nos espoirs s’expriment chaque jour. À vous de les écouter.
L’Assemblée nationale n’est pas une page Facebook – ni votre club privé
Depuis quand l’Assemblée nationale fonctionne-t-elle comme une start-up mal gérée, où la seule communication officielle passe par la page Facebook d’un membre ? Une institution aussi importante ne peut pas se limiter à une communication improvisée et opaque. Attends mais prenez exemple sur vos pairs français. Vous ne les voyez pas communiquer ? Intervenir ? Vous croyez qu’ils le font pour quoi ? Ils ont à coeur de bien faire LEUR TRAVAIL.
Les débats, les votes, les décisions, tout cela doit être transparent. Nous avons le droit de savoir qui défend quoi, qui vote contre nos intérêts, qui préfère se taire et pourquoi.
Mais visiblement, la transparence vous fait aussi peur que la responsabilité. Les délestages sont devenus une habitude au Gabon. Ils paralysent l’économie, détruisent les petites entreprises, compromettent la santé des patients dans les hôpitaux, privent les enfants de lumière pour étudier. Et vous, qu’avez-vous fait ? On a compris que les Bongo ont mis le pays à terre mais vous qu’on a placé pour bouger les lignes, c’est à partir de quand qu’on sentira que vos mots sont l’écho de nos maux ?
Chaque année, le budget est voté, et chaque année, la crise énergétique s’aggrave. Pourtant, combien d’entre vous ont eu le courage d’en faire un vrai combat ? Les féminicides ? Les projets des lois à quel niveau ?
Le problème de l’électricité au Gabon ne date pas d’hier, il n’a pas surgi par magie le 30 août 2023. C’est une bombe à retardement que vous avez tous regardée sans bouger. Il aurait fallu faire preuve d’initiative, de courage politique, et peut-être même… travailler un peu.
Quand vous n’étiez pas au Parlement, on aurait accepté que vous vous plaignez avec nous mais là, quand même chers honorables, il faut arrêter ça.
L’Histoire retiendra qui a œuvré pour le peuple et qui l’a trahi.
Alors oui, nous sommes en colère. Oui, nous parlons fort. Et nous continuerons, que cela vous plaise ou non.
Parce que pendant que vous vous offusquez des critiques, nous, nous subissons les coupures d’électricité, l’inflation, la précarité et l’absence totale de réformes dignes de ce nom. Les recrutements, l’insécurité, les coups, blessures et parfois la mort de ceux qui doivent nous protéger.
À ceux qui trouvent nos mots trop durs : écoutez-nous.
À ceux qui se sentent visés : agissez.
À ceux qui veulent esquiver le débat : je le répète, l’Histoire retiendra qui a œuvré pour le peuple et qui l’a trahi.
Après, ça, c’est ce que ferait un parlementaire élu. Mais étant nommés, certains ont préféré faire allégeance pour garantir la pérennité de leur situation et leur siège.
Les élections vont arriver et, peut-être, on viendra à l’Assemblée nationale.
Parlementairement vôtre.