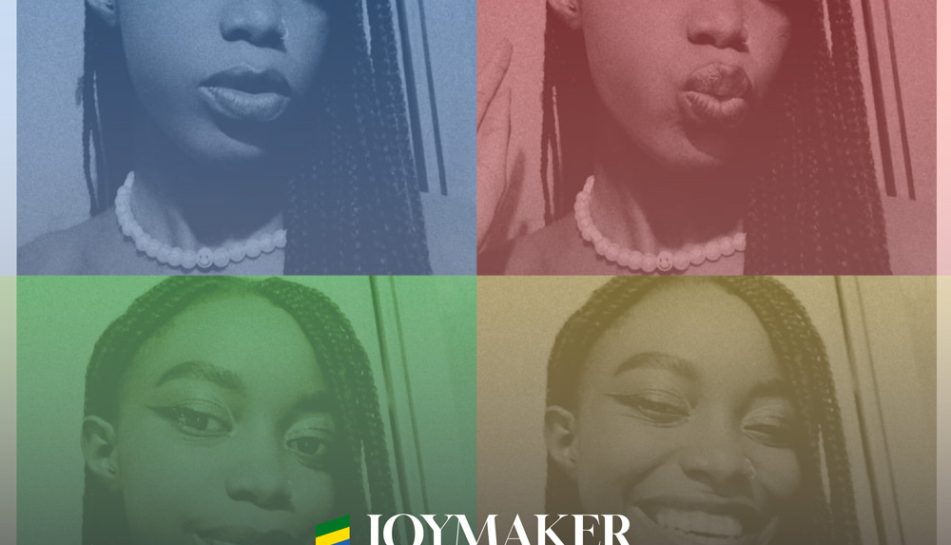Selon leurs promoteurs, « le mot “viol” est parfois censuré sur Internet en raison de plusieurs raisons liées à la sensibilité du sujet et aux politiques de modération des plateformes numériques. » Sachant que le viol est un sujet extrêmement sensible et traumatisant, les plateformes en ligne (en particulier les réseaux sociaux) censurent certains termes ou les modèrent de manière stricte pour protéger les utilisateurs, notamment les victimes de violences sexuelles, et éviter de provoquer des réactions négatives ou de la souffrance inutile.
Vu qu’internet en général et les réseaux sociaux en particulier, sont désormais les canaux d’information les plus utilisés chez les moins de 16 ans, il ne faudra pas qu’on s’étonne si d’ici quelques années, plus aucun adulte n’est apte à définir ce terme ou même à nommer l’acte qu’il définit. Cette censure excessive risque de banaliser le problème en le rendant presque invisible dans le discours public, tout en privant les jeunes d’une compréhension adéquate et nécessaire de ce fléau social.
Mais là n’est pas le sujet du jour, même si je pense qu’il était important de rappeler ce fait, aujourd’hui j’ai envie de parler des réactions des familles gabonaises face à ce que j’appellerai « viols internes » tout au long de mon article.
Les « viols internes » désignent ici les cas de violences sexuelles commises au sein même des familles, souvent par des proches tels que des pères, des oncles ou des frères. Ces situations sont particulièrement complexes et délicates à aborder, tant sur le plan émotionnel que social.
Dans de nombreuses familles gabonaises, la culture de la honte et du silence entoure encore trop souvent ce type de violences. Les victimes, souvent des femmes ou des enfants, peuvent se sentir isolées et craintives à l’idée de dénoncer les agresseurs, redoutant les répercussions sur leur réputation et sur celle de leur famille. Cette omerta renforce l’impunité des auteurs et empêche les victimes d’accéder à l’aide et au soutien dont elles ont besoin.
Les réactions des familles face aux viols internes varient considérablement, généralement selon l’importance du membre victime ou même de son bourreau. Selon qu’il s’agisse d’une cousine éloignée ou d’un riche oncle, certaines tentent de minimiser les faits, de les justifier ou de les ignorer, blâmer la victime ou la forcer à se taire espérant que le problème disparaîtra de lui-même.
Combien de fois a-t-on entendu des « vous voulez accuser quelqu’un de viol, or ils ont sans doute juste fait l’amour ensemble » ou des « n’est-ce pas mieux qu’il fasse le désordre dans sa famille plutôt qu’il aille le faire ailleurs où on va l’envoyer en prison ? Vous savez ce que la prison peut faire à un homme ? » sortir de la bouche des chefs de familles censés résoudre des problèmes du genre ?
Récemment, on a tous entendu parler de l’histoire que beaucoup soupçonnaient déjà d’exister dans la famille d’un célèbre homme d’affaires et politique déchu. En regardant l’interview de son ex-femme, j’ai eu froid dans le dos. J’étais partagée entre l’empathie que j’éprouvais pour elle quant aux menaces qu’elle recevait de lui et le dégout que j’avais de l’entendre dire qu’elle a tenté de raisonner sa fille de 13ans en lui disant qu’elle devait arrêter de faire ce qu’elle faisait avec son père.
Comme si l’enfant était selon elle partie prenante volontaire des abus qu’elle subissait de son mari. Je ne vous raconte pas comment ça a été dur d’entendre qu’elle a pris la fuite à l’étranger en laissant sa fille seule à la merci d’un homme aussi violent que puissant… Bref !
Quand certains choisissent la fuite ou le silence, d’autres au contraire, prennent conscience de lagravité de la situation et s’efforcent de soutenir la victime, en l’encourageant à porter plainte et à chercher de l’aide professionnelle. Ceux qui ont le courage de dénoncer sont accusés de vouloir diviser ou jeter l’opprobre sur la famille. Mais, même dans les cas où les familles sont prêtes à agir, elles peuvent se heurter à de nombreux obstacles. La « culture gabonaise » (du viol) en est un.
Cette même culture qui veut que « le linge sale se lave en famille », plus celui qui l’a sali est puissant et plus le linge est sale, moins on doit l’exposer au voisinage. Les traditions et les croyances peuvent perpétuer des attitudes protectrices envers les agresseurs, en invoquant des notions de devoir familial ou de réconciliation… « On est chrétien, on doit pardonner. »
Celui donc, qui se risquera quand-même à dénoncer se frottera souvent à un autre obstacle, le système judiciaire gabonais. Bien que progressant, la justice gabonaise reste encore confrontée à des défis en matière de traitement des affaires de violences sexuelles. On est peu préparés, peu empathiques, les délais de procédure peuvent être longs, les preuves difficiles à rassembler, les pot-de-vin, et les risques de stigmatisation pour les victimes persistent.
On connait tous d’avance les répliques des forces de police « elle était habillée comment aussi ? elle faisait quoi si tard dehors ? » quand une femme tente de déposer une plainte, ou les phrases du style « la faute aux parents, comment on peut laisser un enfant de 2 ans se balader en slip dans la maison sachant qu’il y a un homme adulte là ? » quand il s’agit d’un enfant qu’un malade est venu agressé chez lui…
A force de normaliser le fait qu’un vêtement peut justifier un viol, le silence et les dissimulations, on se rend tous coupables. La génération que nous sommes doit comprendre que la culture du viol passe aussi par le silence à cause de la peur… C’est sans doute dur de le dire ainsi, mais c’est vrai. Je me souviens encore de la vague de haine et toutes les menaces de mort (et de viol, tiens) que j’ai reçues via twitter parce qu’un jour j’ai osé dire qu’une personne adulte qui a été victime d’un pédophile dans son enfance et n’ose pas aujourd’hui dénoncer (même anonymement) cette personne, la laissant poursuivre son travail quotidien avec d’autres enfants se rendait d’une certaine façon coupable de complicité.
C’est aujourd’hui encore mon point de vue. Si plus jeune un oncle avait abusé de moi par exemple, que j’apprenais qu’un jeune membre de ma famille venait à l’accuser et qu’il ne pouvait pas porter sa voix assez haut, pourquoi, maintenant que je suis devenue adulte et que je sais qu’il ne pourra plus me toucher, choisirais-je de garder le silence sur ce que j’ai vécu ? Surtout si je sais que ça peut l’empêcher de le refaire ? Parce que, la culture du viol, c’est bien simple. Bref…
Comme sur le méta, les viols internes sont un sujet tabou dans les familles gabonaises. Ils ont lieu, beaucoup le savent mais très peu osent en parler, très peu osent mettre un nom sur ce que sont les oncles qui dépucellent les enfants de leurs proches, de peur d’être la risée des membres de sa famille. Le bourreau bien connu de beaucoup d’entre nous est souvent malheureusement plus protégé que ses victimes. On ne le punit même pas par une mise à l’écart, obligeant les victimes de violences sexuelles à le côtoyer, pendant les rassemblements familiaux ou d’autres.
Il est bon de noter que les victimes de viols internes peuvent souffrir de traumatismes psychologiques et mêmes physiques à long terme, ce qui nécessite un soutien psychologique et émotionnel adéquat. Si elles ne peuvent trouver ce soutient au sein de leurs familles, vers qui vont-elles se tourner ? Parce qu’on est incapable de répondre correctement à cette question, beaucoup se retrouvent à répéter le schéma. Et ainsi se perpétue la culture gabonaise du viol.
La Fière Trentenaire