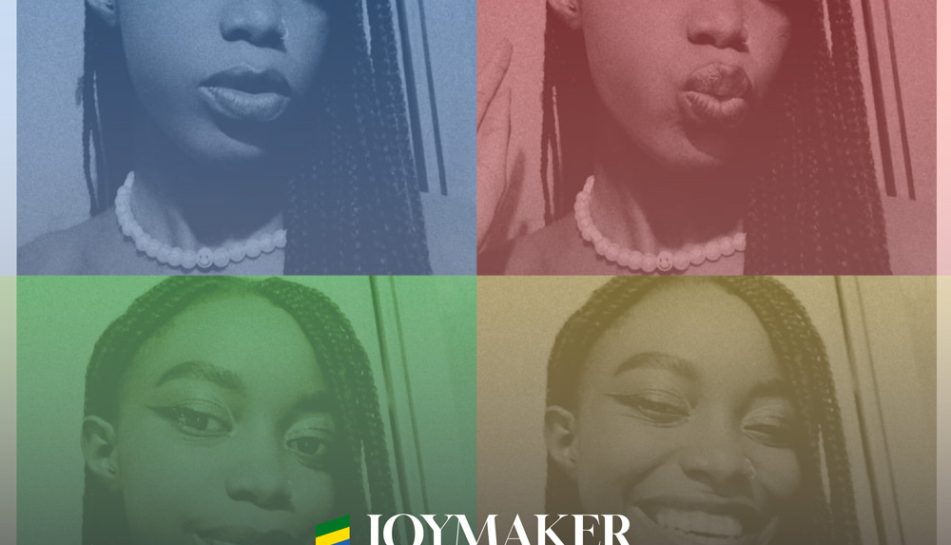Certains pourraient penser que ces situations sont des cas isolés. Malheureusement, elles sont la norme. Dans le privé comme dans le public, les employeurs semblent s’être passés le mot : les salaires ne sont pas une nécessité immédiate. Les fonctionnaires attendent des mois, parfois des années, pour percevoir leur dû. Dans certaines entreprises privées, c’est la même rengaine : tu travailles, mais rien ne garantit que tu seras payé. Alors, comment payer le loyer ? Comment nourrir sa famille ? Comment assurer la scolarité des enfants ?
Le pire dans cette situation, c’est le silence qui l’entoure. Une omerta nationale. Les victimes s’épuisent à protester, à revendiquer leurs droits, mais les promesses creuses et les échéances non tenues sont tout ce qu’elles reçoivent en retour. Pire, certaines entreprises, lorsqu’elles sont interpellées, réagissent par la menace ou le licenciement.
Travailler pour ne rien gagner : une tragédie banalisée
Au Gabon, de nombreux travailleurs en sont réduits à survivre sur le dos de leurs familles, de leurs amis ou de crédits qu’ils ne peuvent pas rembourser. On voit des pères de famille qui doivent emprunter de l’argent pour aller travailler. Des enseignants, des agents de santé, des ouvriers du BTP, des employés de l’administration qui peinent à s’acheter un repas pendant que d’autres accumulent des fortunes sur des comptes bancaires à l’étranger.
La situation touche tout le monde, mais certains secteurs sont plus durement impactés. Les médias ont rapporté le cas de cet employé de la SOGATRA retrouvé dans les locaux de l’entreprise qui a perdu la vie faute d’avoir pu acheter ses médicaments. Une scène qui aurait pu être évitée, mais qui, faute de volonté politique, se répète encore et encore.
Et que dire des retraités ? Après avoir servi l’État toute leur vie, ils sont abandonnés à leur sort, livrés à la mendicité. Il n’est pas rare de voir des vieux, dossiers sous le bras, errer de ministère en ministère à la recherche d’un paiement qui n’arrivera peut-être jamais. Des vieillards, anciens professeurs, anciens médecins, anciens fonctionnaires, réduits à dormir devant la CNSS dans l’espoir d’un miracle.
Un mépris institutionnalisé
L’indifférence des autorités face à cette crise est glaçante. Le silence du gouvernement est un message en soi : le bien-être des citoyens n’est pas une priorité. Les ministres, eux, sont bien payés, leurs salaires tombent à temps, ils roulent dans des voitures de luxe et s’envolent en première classe pour des conférences internationales. Ils vivent dans une bulle dorée, complètement déconnectés de la réalité du peuple.
Et pourtant, la solution est simple : payer les salaires à temps, garantir les droits des travailleurs, renforcer les contrôles sur les entreprises qui exploitent leurs employés. Mais encore faudrait-il que ceux qui détiennent le pouvoir aient une volonté politique réelle de changer les choses.
Au lieu de cela, les mêmes discours vides sont servis à chaque crise : “Nous allons régler la situation”, “Nous comprenons la souffrance des travailleurs”, “Des mesures sont en cours”. Mais au final, rien ne change.
Combien de temps encore cette situation pourra-t-elle durer ? Pendant combien d’années encore les travailleurs gabonais devront-ils mendier ce qui leur revient de droit ? Le danger de ce mépris généralisé, c’est la colère qu’il alimente. Car un peuple qui souffre en silence finit toujours par exploser.
Le Gabon mérite mieux. Son peuple mérite mieux. Il est temps que les choses changent.