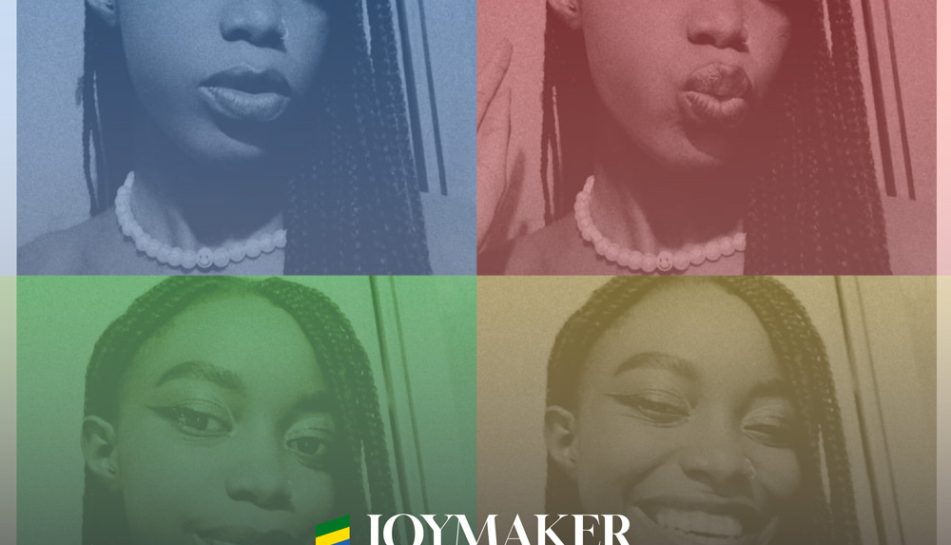Ces dernières années, le Gabonais est longtemps resté en détention à domicile pour « préserver sa sécurité », tantôt contre des maladies meurtrières, tantôt contre d’éventuelles ripostes au coup de la « liberté » qui parce qu’ayant été « non sanglant » a pourtant été bien accueilli par ceux-ci. Les récents événements dans le monde de la politique me donnent plus l’impression que c’était pour que les plus rusés d’entre nos décisionnaires se remplissent davantage le ventre pendant que toi, moi et nos proches, nous battions pour trouver à manger, réaménager nos horaires de travail et autres. Quoi qu’il en soit, maintenant que nous sommes libres de nous mouvoir dans le pays et en dehors qu’importe l’heure et la raison, rien ne permet réellement que ce soit possible… Enfin, sauf les moyens de transport qui se multiplient en ville ; En plus des bus climatisés, taxis climatisés, taxis lambda, taxis bus, taxis clandestins (clando), on a désormais aussi des tuk tuk (ou touk touk je ne sais pas je suis Ghisir), bien urgents pour l’économie du pays… Bref, ce n’est pas le sujet aujourd’hui. On en parlera sans doute une autre fois.
Donc… Le Gabonais est un pacifiste qui ne demande pas grand-chose. Lorsqu’il quitte le « confort » de sa maison pour se mettre dans la rue c’est qu’un bouchon a été poussé trop profond dans sa gorge et qu’il s’en étouffe. Lorsqu’il réclame quelque chose à coup de manifestation, c’est que celle-ci lui est réellement due, qu’il s’agisse de bourse ou d’emploi, le gabonais a trop peur de la répression pour se risquer quand il a tort. Résultant, tout ce que le gabonais, bien qu’issu d’un pays aux richesses visibles variées, a pour lui ce sont les délestages, les embouteillages, les nids de poules, la privation et la rationalisation des denrées alimentaires et les métiers ingrats ou le chômage, à quoi s’ajoute désormais la probabilité de mourir sur son lieu de travail.
Je ne veux pas être censurée, mais j’ai envie de dire « M*rde, quelle m*rde et p*tain de m*rde, quel pays de m*rde… ». Voilà une fille, une mère de famille, une tante, une sœur, une amie qui sort de chez elle le matin, va faire un métier ingrat et ne rentre jamais parce que les conditions de travail IMPOSÉES par le Code du Travail (pourtant applicable à TOUTES les entreprises intervenant au Gabon) via le Décret N°01494 définissant les Règles Générales d’HSE Sur Les Lieux de Travail au Gabon, ne sont respectées que par les entreprises qui le choisissent et personne ne va tomber ?
[Si c’est long, relisez lentement, s’il vous plait… Il faut bien comprendre la partie là, c’est important pour la suite.]
Je ne sais pas combien d’entre vous se sont déjà rendus sur les chantiers et sites gérés par les entreprises asiatiques au Gabon, les chinoises en particulier. Je disais récemment qu’en majorité, ce sont des mouroirs connus de nos autorités. Pour y avoir fait plusieurs visites, on y voit l’inimaginable. Des latrines en guise de WC, des dortoirs surchargés, des postes à souder fixés près de cuves de stockage d’hydrocarbures, des cubitainers troués et sans bacs de rétention servant de récipients de stockage de produits chimiques, des employés travaillant sans équipements (de protection et autres outils de travail) adéquats, et j’en passe. Un enfer pour les âmes d’HSE.
En pareilles circonstances, comment espérer rentrer chez soi sans dommage immédiat ou une maladie professionnelle si non par la foi ?
Un employé ne devrait pas perdre la vie en tentant de la gagner ; Mais la faute à l’Etat !!! C’est lui qui se remplit les poches, du moins celles de ses dirigeants, sur la misère des gabonais normaux. Je suis révoltée qu’on se soucie plus de politique et de l’image du pays aux yeux du monde, que de la vie et du bien-être de ses citoyens. Que fait l’Inspection du Travail ? Quelles sont les missions de la Direction Générale de la Santé et Sécurité au Travail ? Pourquoi les entreprises dont la non-conformité aux textes de loi est palpable au quotidien continuent d’obtenir des permis d’exploiter dans notre bananeraie, Seigneur Jonas !!!??
Je suis choquée par l’égoïsme des gens à qui on a fait confiance par les urnes ou par un quelconque soutien jusqu’ici.
Toutes les vidéos et photos de la défunte qui tournent, la montrent dépourvue d’équipements de protection individuels. Excepté le masque anti-poussière et le gilet de haute visibilité (que je suis fatiguée, en tant qu’HSE de répéter aux gens qu’ils ne servent pas à protéger, mais à rendre davantage visible), Madame IBRAHIME (paix à son âme) n’a rien pour se protéger ; pas de chaussures de sécurité, pas de vêtements de travail, pas de casque, pas de lunettes de protection… RIEN de ce qui est OBLIGATOIRE par la loi (ni même les procédures internes quand on est une structure qui se respecte exerçant dans un pays qui se respecte) pour réaliser ses activités de manutention. Et dites-vous que ces images ont été prises lors d’un reportage pour un web média (mené par un créateur de contenu célèbre). Donc, alors que les entreprises, lorsqu’elles sont informées de l’arrivée des caméras dans leurs locaux, font en sorte de se rendre présentable devant elles, le HSE de cette structure s’est (sans doute) dit que ça ne serait pas trop insultant pour nos intelligences de ne rien changer de d’habitude.
Je parle du HSE même, entre temps, je connais ses réalités. Souvent muselés par les chefs d’entreprises, nos profils ne sont jugés utiles que lorsqu’il y a des audits et des contrôles. C’est pour ça que je le redis, LA FAUTE A L’ETAT, et aux entités qu’il crée pour défendre les droits des salariés et veiller à l’effectivité des devoirs des employeurs, qui ne vont sur les chantiers que pour se prendre leur enveloppe annuelle. Ceux-là même qui deviennent aveugles devant les risques et les non-conformités dès qu’on a porté des billets jusqu’à leurs yeux… QUEL PAYS DE M*RDE !
En vrai, on espère quoi ? Qu’est-ce qu’on n’a pas vu avec FOBERT ???? Les employés ont lancé une alerte dont la structure en charge du risque sanitaire et phytosanitaire s’est saisie, que s’est-il passé ensuite ? Licenciement de son Directeur Général ? « Pourquoi ? Mais pourquoi pas ? Je suis là, je ne comprends rien… ». De toutes façons, et je vais finir là, quand eux-mêmes vont pour les visites des sites, que portent-ils d’autre que leurs treillis, leurs deux pompons et leurs ensembles ABACOST ? Rien.
On n’est visiblement pas sorti de l’auberge. L’année dernière, un accident se produisait on shore et endeuillait des familles gabonaises, enquêtes demandées, grands discours, promesses, on est là, on va encore faire comment ? Cette fois encore, je suis désolée pour la famille, mais il semble qu’on va de nouveau se poser la question, ON VA ENCORE FAIRE COMMENT ?
La Fière Trentenaire :*