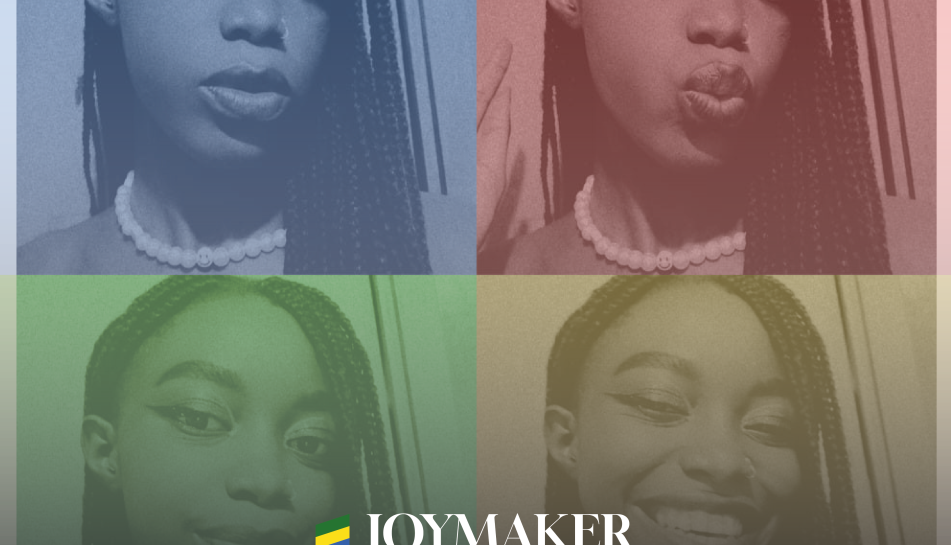Quand je travaillais à Dakar dans un centre d’appel pour une entreprise française, je n’avais jamais mis les pieds en France. Pourtant, je pouvais dire à n’importe quel client où en était son dossier, sa commande ou sa réclamation. Pourquoi ? Parce qu’il y avait une procédure numérique.
Un système clair, centralisé, consultable. Avec des étapes précises, des délais définis et surtout, un suivi transparent.
Et ça rassurait. Le client savait que sa plainte était entre de bonnes mains. Il pouvait voir l’évolution. Et de notre côté, on était formés, outillés, et efficaces.
Bref : tout le monde gagnait du temps… et de la confiance.
Maintenant, remettons les pieds à Libreville.
On te dit : « Vous serez contactés dans 3 jours ouvrés ».
Résultat ? Trois mois plus tard, toujours rien. Et parfois, on te dit, avec une sérénité olympique : « Ah, on a perdu votre dossier. Revenez déposer ça en physique ».
EN PHYSIQUE ?
En 2025. À l’ère des applications, des QR codes, du télétravail, du cloud et de l’intelligence artificielle.
Comme si la modernité était un privilège pour ceux qui vivent “ailleurs”. Comme si digitaliser les services publics, c’était encore considéré ici comme un “bonus” et non une nécessité de base.
Et le plus grave ? Ce ne sont pas juste des retards.
Ce sont des vies entières qu’on suspend :
- Un remboursement attendu,
- Une bourse qui n’arrive jamais,
- Une aide sociale évaporée,
- Une pension oubliée quelque part dans un tiroir fermé à clé.
ET AILLEURS ?
Mon grand frère vit au Canada. Il m’a raconté que quand il y a une coupure d’eau ou d’électricité, il peut suivre l’évolution en ligne :
- Zone impactée,
- Cause de la panne,
- Temps estimé de retour à la normale.
Pas besoin d’appeler cinq numéros.
Pas besoin de supplier une standardiste.
Pas besoin de deviner si le problème vient de chez toi ou si c’est tout le quartier, pas besoin d’attendre le communiqué de la SEEG qui te dira quel animal a rongé le câble ou qu’une nouvelle enquête pour sabotage a été ouverte.
L’info est là, accessible, mise à jour.
Ici ? Même un simple communiqué de la SEEG, c’est devenu une épreuve.
Et quand il finit par sortir, c’est souvent un fichier PDF sec comme une coupure de 72h, sans véritables détails, avec des excuses toutes faites.
Ce n’est pas qu’un problème technique. C’est une question de mentalité.
Mais au fond, a-t-on seulement le souci de fournir un bon service dans certaines administrations ?
Le souci de voir un administré sortir satisfait, content d’avoir suivi une procédure fluide, sans stress, sans piston, sans avoir glissé un “petit quelque chose” à un agent pour “faire avancer le dossier” ?
Ici, on remercie rarement l’administration pour son efficacité.
On remercie plutôt “tonton au ministère” ou “la dame qui a accepté le Coca”.
Et comment veut-on améliorer ce qu’on ne mesure même pas ?
Sans indicateurs, sans suivi, sans envie de savoir si les gens sont bien servis ?
La vérité, c’est que dans bien des cas, les agents eux-mêmes ne connaissent pas les processus, ou bien chaque agent a “sa méthode maison”, transmise oralement comme une vieille recette de famille.
Résultat : tout repose sur l’humeur du jour… et la chance.
Tant qu’on continuera à improviser au lieu de formaliser, on restera bloqués dans des logiques d’un autre siècle.
Tant qu’on pensera que “digitaliser” c’est juste “ouvrir une page Facebook” ou faire un site qu’on ne met jamais à jour, on passera à côté de l’essentiel.
Alors qu’en vrai, pour commencer à faire mieux, il ne faut même pas des budgets gigantesques (je ne dis pas aussi que c’est 10.000 FCFA, la qualité a un prix).
Juste du sérieux et un peu de bon sens.
Cinq choses simples, faisables demain matin :
1. Un numéro de dossier unique
Donné automatiquement à chaque démarche, pour un suivi traçable.
2. Une plateforme ou un tableau de bord minimal
Même une page web ou une appli basique suffit pour informer les citoyens de l’état d’avancement de leurs demandes.
3. Des délais clairs, visibles et respectés
Si tu dis “7 jours ouvrés”, alors c’est 7. Pas 73.
4. Des notifications automatiques
SMS, e-mail, WhatsApp : peu importe.
Mais qu’on t’informe à chaque étape du traitement.
Parce que “pas de nouvelles” ne doit plus être une méthode.
(Ici c’est quand il y a les grands meetings que tu reçois des messages de numéros inconnus et tu te demandes comment ils ont eu ton numéro.)
5. Un manuel de procédures standardisé dans chaque service
Fini les “venez lundi voir Madame”, “revenez mercredi voir Monsieur”.
Ce n’est pas une chasse au trésor et en vrai on n’a pas que ça à foutre à courir derrière les gens. On a aussi des boulots.
Ce n’est pas une affaire de numérique. C’est une affaire de respect.
Digitaliser, c’est permettre à quelqu’un d’avoir des réponses sans supplier.
C’est prouver que son temps, son argent, ses efforts, ont de la valeur.
C’est envoyer le message que l’État est organisé, qu’il suit, qu’il écoute.
Parce qu’à force de maltraiter les citoyens par des procédures brumeuses, on crée du rejet, de la frustration, du désengagement.
Et pire : de la résignation.
Et si on veut vraiment parler d’émergence, de performance, d’innovation, de restauration des institutions et de redonner la dignité aux Gabonais…
Alors il faut commencer par ne plus perdre les dossiers.