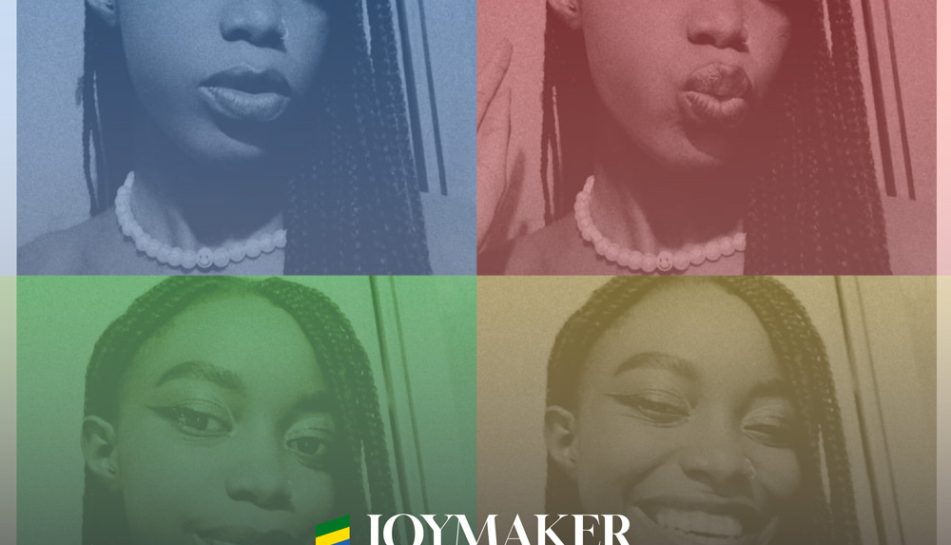La cause de ce handicap : une malformation au niveau des globules rouges dans le sang.
Elle se caractérise par des anémies sévères et des douleurs régulières, subites et constantes. Parfois à la tête, mais aussi aux membres inférieurs et supérieurs, ce qui fait que des fois tout le corps du malade n’est que douleur, une douleur INTENSE.
Au Gabon, 25 % de la population est porteuse du gène sans être malade, ce qui veut dire qu’une personne sur 4 est AS ; et la proportion des malades drépanocytaires est estimée à 2 % de la population.
Selon moi, ces chiffres montrent que la drépanocytose doit être reconnue comme une priorité de santé publique dans notre pays.
En tant que tante de 3 enfants drépanocytaires, j’ai côtoyé de très près les crises régulières, le quotidien difficile des parents et la douleur de ces enfants, et parfois l’inévitable. Et je peux affirmer que la prise en charge d’un enfant drépa n’est pas chose aisée en général, et encore moins ici au Gabon. Et ce sur plusieurs aspects :
Niveau scolarité
À chaque rentrée des classes, ma sœur se doit d’informer le maître ou la maîtresse de la maladie de l’enfant. Il/elle doit comprendre que l’enfant ne ment pas quand :
- il va demander la permission toutes les 30 minutes pour aller uriner (un drépa boit énormément d’eau) ;
- il pourra avoir des douleurs subites, parfois sans explication, en cours de journée, et qu’il faudra qu’il aille à l’infirmerie ou qu’on prévienne ses parents.
Malheureusement, très souvent, les écoles n’ont pas d’infirmerie compétente pour prendre en charge les premières minutes de crises.
Heureusement, nous avons souvent eu affaire à des maîtresses compréhensives qui prenaient au sérieux les besoins des enfants. Mais ce n’est pas tout le temps le cas.
Niveau économie
Les enfants malades vivent très souvent au rythme des crises, qui surviennent en moyenne une fois par mois, parfois un peu plus.
Ces épisodes, extrêmement douloureux, nécessitent régulièrement des hospitalisations.
Malheureusement, en raison des limites du système de santé public, nous n’avons d’autre choix que de nous tourner vers des cliniques privées pour offrir aux enfants une meilleure prise en charge.
Une fois sortis de l’hôpital, les ordonnances s’enchaînent : médicaments, examens complémentaires, suivis spécialisés…
Résultat : un bilan financier mensuel particulièrement lourd, et un endettement sans fin.
Niveau santé
Le protocole de prise en charge des patients drépanocytaires n’est malheureusement pas bien maîtrisé dans tous les établissements de santé.
Il arrive souvent, par exemple, qu’en cas d’hospitalisation de l’un des enfants, ma sœur ou mon beau-frère doive expliquer eux-mêmes aux infirmiers la conduite à tenir, tout en rappelant les spécificités médicales du dossier de leur enfant.
Une situation épuisante, qui souligne à quel point la connaissance de la maladie reste encore insuffisante au sein de notre système médical.
On a parfois le sentiment que certaines structures médicales ne réalisent pas à quel point chaque crise, même minime, peut avoir des conséquences graves chez un enfant drépanocytaire.
Un simple symptôme, bénin en apparence, peut rapidement conduire à l’inévitable.
Je me souviens d’une fois : l’une de mes nièces malade présentait les premiers signes d’un palu. Par précaution, ma sœur l’a immédiatement conduite aux urgences.
L’infirmière qui l’a reçue, visiblement peu préoccupée, s’est permis de dire sur un ton léger :
« Ce n’est qu’un début de palu, vous auriez pu aller en pharmacie. »
Même après qu’on lui ait précisé que l’enfant était drépanocytaire, elle n’a pas semblé saisir la gravité potentielle de la situation.
Ce jour-là, elle a été hospitalisée.
Heureusement, toutes les structures de santé ne réagissent pas de cette manière.
Mais cet exemple montre bien à quel point la sensibilisation à la drépanocytose reste encore insuffisante, même chez certains professionnels de santé.
Je sais que plusieurs viendront avec un discours moralisateur disant :
“Ils sont irresponsables, pourquoi n’ont-ils pas fait les tests avant de se mettre ensemble ? S’ils les avaient faits, ils auraient compris qu’ils ont le gène de la maladie et n’auraient pas fait d’enfants ensemble.”
Ce qui n’est pas faux en soi.
Mais on pourrait aussi dire :
« Et si on en parlait un peu plus dans les médias afin que tout le monde sache ce que c’est ? »
« Et si l’État lançait des campagnes de sensibilisation à grande échelle pour inciter les gens à se faire dépister ? »
« Et si l’électrophorèse devenait gratuite afin de rendre cet examen plus accessible à tous ? »
“Et si … Et si… ?” Avec des si, on pourrait s’asseoir et refaire le monde. Mais tel n’est pas l’objectif.
J’en parle aujourd’hui parce que les enfants sont là, et que cette réalité fait partie de notre quotidien.
Ce n’est peut-être pas la faute de l’État, mais ces enfants ne méritent-ils pas qu’il y ait une prise en charge adaptée à leur cas ?
Que ce soit au niveau de leur scolarité, des finances de leurs parents ou, plus important encore, de leur santé ?
ℹ Chaque 19 juin, on célèbre la Journée mondiale contre la drépanocytose.
Une journée pour s’arrêter un instant, réfléchir, et agir en conséquence.
Premier pas : connaître son statut. Cher lecteur, connais-tu ton statut ? Es-tu AA, AS ou SS ?
– MissKa