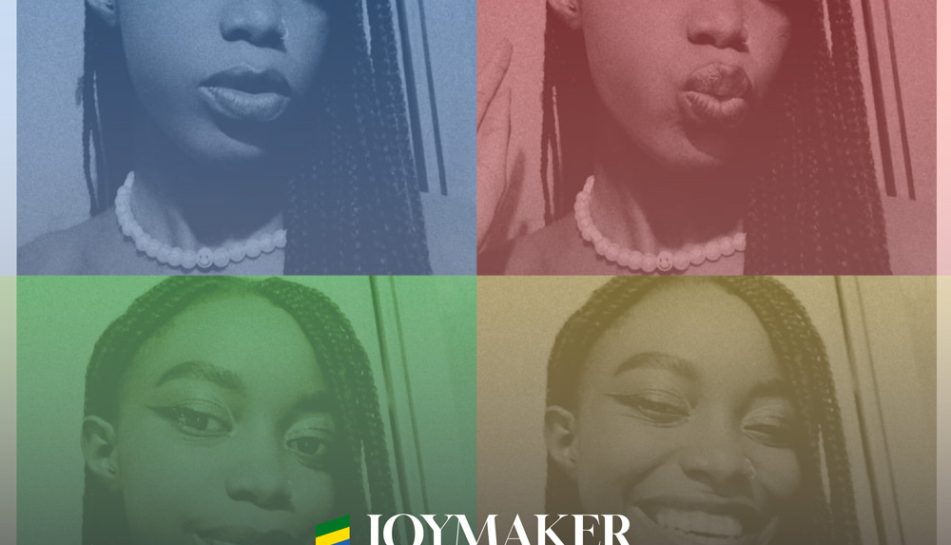S’il y a bien une constante au Gabon, ce sont les méthodes. Gouverner en brutalisant, mépriser les plus précaires, les frapper sans prévenir… On connaît. Et après le PDG, rien n’a changé : les hommes sont restés les mêmes, seule la chorégraphie est différente.
Depuis quelques jours, c’est un spectacle accablant qui se joue dans certains quartiers de Libreville. Des centaines de familles, leurs affaires entassées dehors, attendent de pouvoir rejoindre un parent compatissant — pour les plus chanceux. Les autres ? Rien. Pas d’aide. Pas de solution. Parce qu’une fois de plus, l’État a agi dans l’urgence, en niant les besoins les plus élémentaires de ses citoyens. Se loger, c’est quand même la base.
Ce déguerpissement, censé « assainir » la capitale, aurait pu être défendable si les méthodes ne rappelaient pas celles d’un État profondément irrespectueux du bien-être de ses propres administrés. On aurait pu commencer par indemniser, reloger, dialoguer. Ça a été fait pour certains. Mais pour d’autres, rien. Le néant.
Soyons justes : il y a eu des tentatives de respecter les procédures. Des courriers, des réunions, des délais. Mais la réalité, c’est que de nombreux bailleurs — qui devraient être poursuivis — n’ont pas pris la peine d’en informer leurs locataires. Pourtant, en tant que propriétaires, ils ont l’obligation d’annoncer ce genre de contrainte. Quand on vit dans un État de droit…
Entre ces bailleurs indélicats et les oubliés du Ministère, on compte aujourd’hui plusieurs vies littéralement en danger. Disons les termes : c’est de la précarisation programmée à ce stade. Où iront donc toutes ces familles ? Même celles qui ont été indemnisées doivent aujourd’hui se reloger dans un Libreville où les prix de location explosent. Où sont les logements sociaux tant attendus ? N’aurait-on pas pu, justement, attendre encore un peu que ces infrastructures voient le jour avant de vider des quartiers entiers ?
Cette stratégie qui consiste à faire sans réfléchir, sans prévoir, doit cesser. Le mandat du président actuel est de sept ans. Sept ans, c’est peu. Mais c’est assez pour changer de méthode. C’est assez pour prendre le temps. Pour mener des études sérieuses. Pour anticiper les besoins. Et parfois, ces études sont déjà des actions, car elles posent les bases concrètes d’un développement durable. L’épanouissement du Gabonais passe aussi par là : par la planification, la rigueur, et le respect.
Mais voilà : on préfère faire semblant. Expulser d’abord. Voir après. Et tant pis si, entre deux camions de déménagement, des familles s’effondrent.