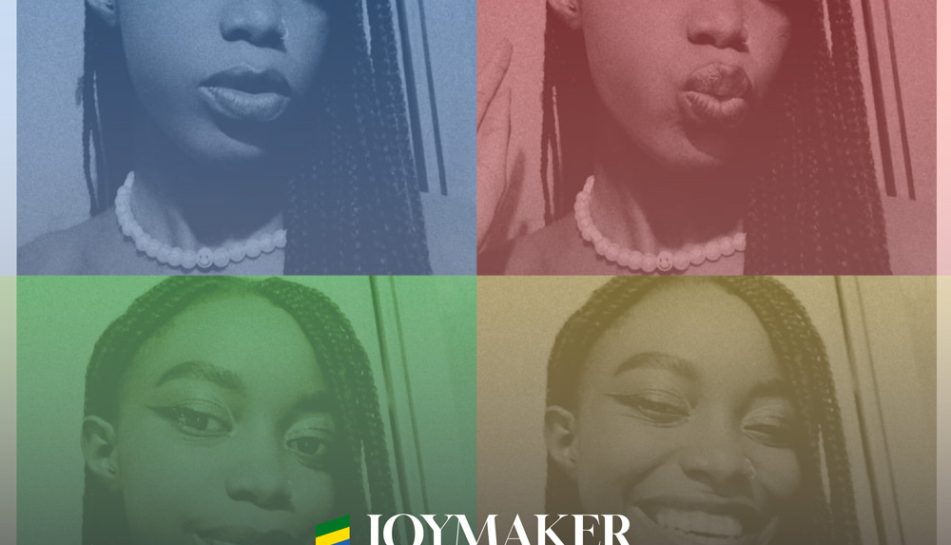Pour ceux qui n’iront pas beaucoup plus loin dans cet article, je tiens à rappeler que je ne cite que des faits vérifiables à travers les déclarations faites ici et là. Ça ne sert à rien de me tenir la jambe. Je n’ai rien inventé.
Ceci dit, pour ceux qui ont un peu fait attention, on a tous constaté une gymnastique particulière des différentes institutions, qui auraient dû être restaurées, pour répondre aux besoins du Président de la Transition. De la première version de la Charte qui l’empêchait de se présenter à la nouvelle version de la Constitution, tout est mis en place pour paver le chemin du Général de Brigade.
Autour de lui, d’anciens opposants et des PDGistes mis de côté par l’ancien régime : une cour de partisans uniquement là pour atteindre ses desseins. Rappelons-le, BCON a lu Machiavel… qui défend dans Le Prince l’idée qu’un dirigeant peut utiliser la ruse et la perception pour maintenir son pouvoir, affirmant même que l’apparence de la vertu peut être plus importante que la vertu elle-même et que les dirigeants doivent parfois user de tromperie. Dès lors, on peut clairement se dire qu’il n’a jamais été question de partir après la transition.
Modification de la Charte de la Transition
Initialement, la Charte de la Transition stipulait clairement que le Président de la Transition ne pouvait pas se présenter aux futures élections. Un gage de bonne foi censé rassurer les populations sur la sincérité du coup de libération. Mais comme par enchantement, la révision de cette charte a progressivement ouvert la porte à une candidature du Général. Une stratégie bien ficelée où l’on change les règles du jeu au fil du temps pour s’assurer un avenir politique.
Loi pour la polygamie
En pleine période de transition, une loi est adoptée permettant aux membres de l’armée d’être polygames. Coïncidence ? Pas vraiment. Cette loi semble taillée sur mesure pour le Président, dont la situation matrimoniale était déjà connue de tous. Par exemple, il était de notoriété publique qu’il entretenait plusieurs relations avant même cette loi, ce qui rend cette réforme pour le moins suspecte. Pendant ce temps, d’autres réformes essentielles attendent encore, comme la modernisation du système judiciaire ou l’amélioration des services publics.
Main tremblante devant les actions de certains
D’un côté, Oligui prône une politique de tolérance zéro contre la corruption et les abus de l’ancien régime. De l’autre, il ferme les yeux sur les dérives de son entourage. Son propre frère, surnommé l’enfant, a été épinglé pour des faits de malversation, mais cela n’a en rien affecté son influence politique. On pourrait aussi citer des figures du PDG aujourd’hui en poste, malgré leur implication passée dans la mauvaise gestion des affaires publiques. Cette indulgence sélective interroge sur la sincérité de la lutte contre les abus.
Responsable de rien
« Tu me les enlèves », disait-il en parlant des incompétents. Mais qui, au Gabon, donne réellement les directives concernant l’utilisation du budget ? La gestion des priorités budgétaires semble erratique : certains projets purement populistes reçoivent des financements immédiats, pendant que des secteurs clés comme la santé et l’éducation restent sous-financés. L’augmentation de la dette devient inévitable pour répondre à ces choix discutables, qui ne servent souvent qu’à soigner l’image du pouvoir en place.
Retour du tribalisme et de la xénophobie
Lorsqu’un gouvernement manque de propositions concrètes, il lui faut un bouc émissaire. Ces derniers mois, les discours tribalistes et xénophobes sont utilisés comme un outil de diversion politique. Des figures publiques, y compris certains ministres, ont tenu des propos ouvertement discriminatoires sans jamais être rappelés à l’ordre. Ce climat contribue à diviser les Gabonais et détourne l’attention des véritables problèmes économiques et sociaux du pays.
Oligui, le bâtisseur ? Peut-être. Mais gouverner, ce n’est pas que construire des routes et poser des premières pierres. C’est aussi assumer ses engagements, faire preuve de cohérence et ne pas instrumentaliser les institutions à des fins personnelles.
On est encore loin du compte. Mais bon… on va y arriver, « un peu un peu ».