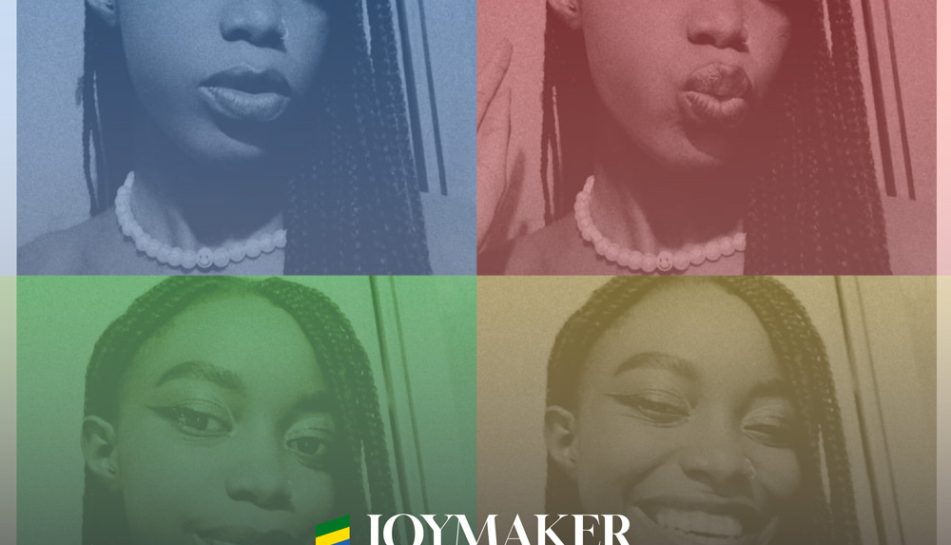J’ai essayé pourtant. Je me suis installé, carnet en main, prêt à chanter les louanges de mon beau pays. J’ai commencé par l’électricité, mais au moment où j’écrivais “nous avançons vers une stabilité énergétique“, le courant a sauté. Silence total. J’ai attendu, le ventilo s’est arrêté, la chaleur s’est installée. Trois heures plus tard, toujours rien. Un voisin a crié “Mettez nous même les groupes, allumez !” et j’ai compris qu’il fallait abandonner l’idée d’un pays électrifié en continu. J’ai griffonné dans mon carnet : Nous sommes passés de l’énergie renouvelable à l’énergie intermittente. C’est une transition écologique… forcée.
J’aimerais bien écrire des choses positives, mais je ne peux pas écrire ce que je ne vis pas.
J’ai voulu parler des opportunités pour les jeunes. À la télé, on nous dit que le chômage baisse, que l’économie se porte mieux, que les entreprises recrutent. Puis, j’ai croisé mon cousin, master en poche, qui fait des livraisons à moto. “Faut bien manger, hein !” m’a-t-il lancé avant de repartir sous la pluie, casque à moitié cassé. J’ai aussi pensé à mon ami qui a envoyé 100 CV et n’a reçu que des refus polis, ou pire, un silence radio. Alors j’ai noté : Les jeunes ont des diplômes, des compétences et de l’ambition. Il ne leur manque plus qu’une chose : un pays qui leur donne leur chance.
J’aimerais bien écrire des choses positives, mais je ne peux pas écrire ce que je ne vis pas.
J’ai voulu parler de la santé. Je suis allé à l’hôpital. À l’entrée, des files d’attente interminables. J’ai vu une femme enceinte attendre des heures, un vieil homme allongé sur un banc, faute de lit disponible. La pharmacie n’avait plus les médicaments nécessaires, mais “on peut vous aider si vous avez quelqu’un en ville pour les acheter en pharmacie privée“. Et si t’es fauché, que tu crèves en silence ? J’ai noté : On dit que la santé n’a pas de prix… Mais ici, elle a un coût, et tout le monde ne peut pas se l’offrir.
J’aimerais bien écrire des choses positives, mais je ne peux pas écrire ce que je ne vis pas.
J’ai voulu parler de l’amour. Mais le goumin m’a rattrapé. Elle est partie. Pourquoi ? “Tu n’as pas de projet”, “Les temps sont durs”, “Un homme doit être stable“. J’ai repensé aux loyers exorbitants des faux agents immobiliers qui réclament leur fameux “100% de commission” avant même que tu signes un bail. J’ai aussi pensé à l’inflation, au prix du poisson qui a triplé, aux légumes qui coûtent une fortune, et aux “commérages financiers” dans les couples. J’ai écrit : L’amour, c’est beau. Mais sans argent, c’est juste une relation d’amitié avec des obligations.
J’aimerais bien écrire des choses positives, mais je ne peux pas écrire ce que je ne vis pas.
J’ai voulu parler des routes. Puis j’ai pris un taxi et me suis retrouvé coincé dans un embouteillage monstre. Pourquoi ? Parce qu’une autorité a décidé de bloquer une route pour son passage. On voit arriver des motards sifflant comme des policiers en plein marathon, des agents de sécurité nerveux, et une file de voitures climatisées roulant à toute vitesse pendant que nous, pauvres mortels, transpirons sous un soleil impitoyable. J’ai noté : Ici, les routes sont à tout le monde. Mais certains sont plus “tout le monde” que d’autres.
J’aimerais bien écrire des choses positives, mais je ne peux pas écrire ce que je ne vis pas.
J’ai voulu parler de la liberté d’expression. Puis j’ai vu un gars critiquer une situation sur Facebook. Deux jours plus tard, il était porté disparu. On apprend plus tard qu’il “collabore avec la justice“. En clair, il est au ngata. J’ai effacé ce que je voulais écrire et noté : Ici, la liberté d’expression est un mythe. Si tu veux parler, assure-toi d’avoir un bon avocat.
J’aimerais bien écrire des choses positives, mais je ne peux pas écrire ce que je ne vis pas.
Alors, peut-être qu’un jour, je pourrai enfin écrire un article joyeux. Peut-être qu’un jour, mon stylo tracera des lignes où l’espoir ne sera pas une blague. Peut-être qu’un jour, je cesserai d’avoir l’impression d’écrire un recueil de plaintes.
Mais pour l’instant, la lumière vient de s’éteindre. Le réservoir d’eau est vide. Mon cousin cherche un autre boulot. Une femme a encore été tuée.
Et moi, je me demande si l’optimisme n’est pas un sport extrême réservé aux inconscients.